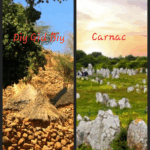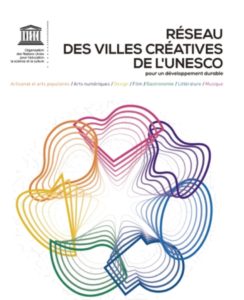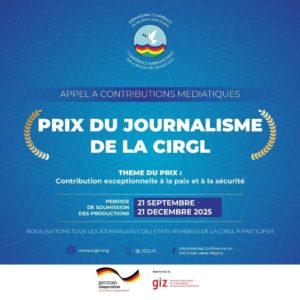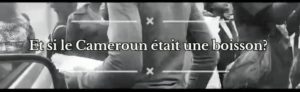Addis-Abeba, 28 janvier 2025 (CAPnews) – La conférence intitulée « Nouvelles formes de coopération et d’accords dans le domaine du retour et de la restitution des biens culturels en Afrique » s’est déroulée ce 27 janvier 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie, en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et la Commission de l’Union africaine. Cet événement historique a mis en lumière l’engagement de l’Unesco à célébrer la richesse et la diversité du patrimoine culturel africain. Plus qu’une simple discussion sur les objets eux-mêmes, la question de la restitution culturelle englobe des enjeux cruciaux liés à l’identité, la mémoire et l’histoire. L’Unesco poursuit son accompagnement auprès des États africains et autres acteurs internationaux dans ces démarches, les considérant comme une nécessité éthique fondamentale pour garantir les droits culturels universels.

Les biens culturels ont été déplacés et arrachés, mais ils n’ont pas été réduits au silence
Les allocutions d’ouverture ont été prononcées par des figures clés, dont le ministre éthiopien du Tourisme, Sileshi Girma, et les représentants de la Commission de l’Union africaine, à l’instar de Mme Angela Martins, responsable de la culture. Mme Catherine De Preux De Baets du Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) pour l’Afrique de l’Est, ainsi que M. Souleymane Bachir Diagne, directeur de l’Institut d’études africaines et professeur de philosophie à l’université de Columbia, ont également pris la parole. M. Diagne a notamment rappelé que les biens culturels africains, bien qu’arrachés à leur terre d’origine et condamnés à l’exil, n’ont pas été réduits au silence. Leur retour, selon lui, est une mission visant à rétablir des liens et à réaffirmer l’importance de ces objets dans la construction de l’identité africaine. Les tables rondes ont offert un cadre propice à l’examen du rôle des musées, des programmes de recherche conjoints et des évolutions récentes dans ce domaine. Des experts africains et internationaux ont contribué à enrichir les discussions en partageant leurs analyses sur l’amélioration de la coopération institutionnelle et des mécanismes de décision. Des exemples concrets de partenariats réussis ont été présentés, illustrant les formes émergentes de collaboration internationale. Les cas récents de restitution ont permis d’ancrer les débats dans une perspective pratique. Parmi les exemples cités : la restitution de plusieurs artefacts namibiens par l’Allemagne, le rapatriement du sarcophage vert en Égypte depuis les États-Unis, le retour d’objets culturels au Ghana et au Kenya, ainsi qu’une sculpture libyenne récupérée depuis la Suisse.

Le trafic en ligne est en croissance
Ces démarches mettent en évidence l’importance d’inclure les communautés concernées dans le processus, notamment grâce à la collaboration intergénérationnelle entre anciens et jeunes pour préserver et transmettre la connaissance artistique. Les participants ont insisté sur la nécessité d’établir un cadre juridique et politique renforcé. L’adoption et la ratification de la Convention de l’Unesco de 1970, visant à lutter contre le transfert illicite des biens culturels, ont été reconnues comme essentielles. D’autres sujets clés abordés incluaient la formation des professionnels des musées, le rôle du marché de l’art, le danger croissant du trafic en ligne et l’importance d’impliquer activement les communautés locales et la diaspora dans les processus de restitution.
La restitution des biens culturels est un point de départ et non une finalité
Une approche globale est indispensable pour garantir le succès du retour des biens culturels africains. La coopération bilatérale doit aller de pair avec les efforts en matière de développement, de recherche et de formation muséale. La restitution doit être envisagée comme un point de départ plutôt qu’une finalité, ouvrant la voie à une réappropriation de la mémoire collective et à une réconciliation avec un passé marqué par les spoliations. Cela constitue également une opportunité pour les jeunes Africains de renouer avec leur histoire, leur culture et leur identité profondément enracinées.